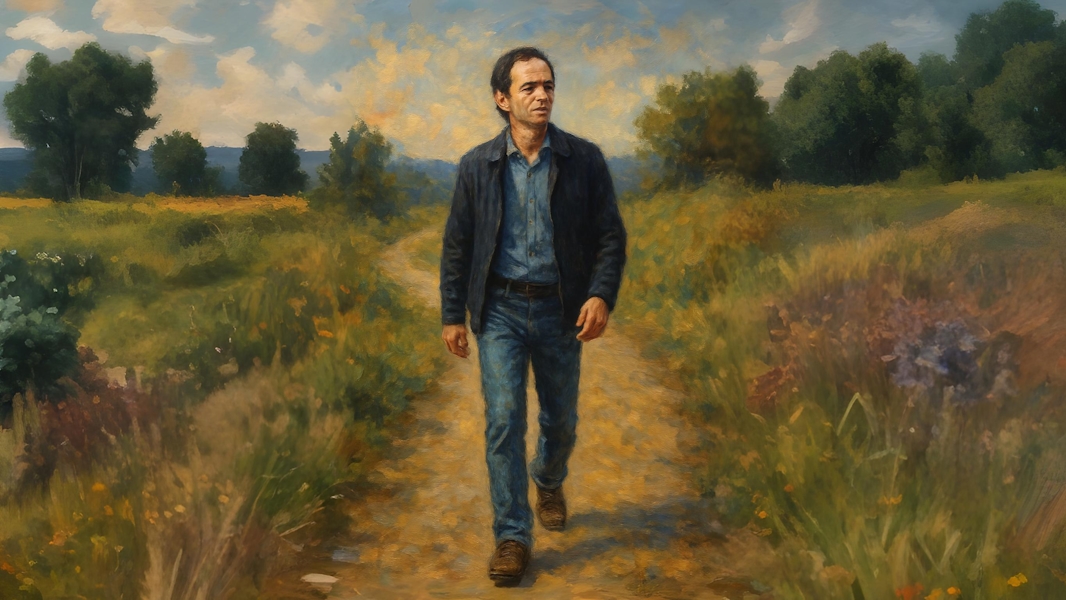"Y’a que les routes qui sont belles…" : les chemins et les routes dans l’œuvre de Jean-Jacques Goldman
Essais
« Y’a que les routes qui sont belles » (01). Cette phrase, devenue emblématique dans l’œuvre de Jean-Jacques Goldman, dit bien plus qu’un goût du voyage. Elle condense une philosophie, une manière d’être au monde. Car chez Goldman, les routes et les chemins ne sont jamais de simples lieux de passage. Ils sont des symboles, des récits, des postures. Ils racontent une tension constante entre le besoin de partir et celui de rester, entre l’élan et l’ancrage, entre la quête de l’ailleurs et la fidélité à ce que l’on est.
Mais encore faut-il entendre leurs différences. Dans ses chansons, la route évoque l’aventure, le mouvement, l’incertain. Elle pousse vers l’avant, même quand on ne sait pas où l’on va. Le chemin, lui, est souvent plus intime. Il parle de mémoire, d’identité, d’un parcours déjà entamé ou hérité. L’une ouvre, l’autre relie. L’une fuit, l’autre revient. Et c’est dans cette dialectique que s’inscrit une grande partie de l’œuvre goldmanienne.
À travers une sélection de chansons emblématiques — "On ira" (02), "Ton autre chemin" (03), "La pluie" (04), "Puisque tu pars" (05), "Je m’en vais demain" (06)… — et plusieurs prises de parole de Goldman lui-même, cet essai propose une traversée de ses routes et chemins intérieurs. Une exploration sensible et thématique, où la marche devient métaphore de l’existence. Car chez Jean-Jacques Goldman, il n’y a pas de carte. Il n’y a que des pas. Et toujours cette idée simple : avancer.
SOMMAIRE
Chemins de vie : l’origine et l’ancrage
Le chemin des autres : "Ton autre chemin" ou l’énigme de l’âme
Le chemin de soi : "Bonne idée" ou l’inventaire de la vie reçue
Le chemin des origines : "Tu es d’un chemin" ou l’affirmation d’une filiation
Routes de fuite, routes de foi : partir, malgré tout
"On ira" : la route sans destination
"Je m’en vais demain" : écrire sa propre route
"Puisque tu pars" : partir sans fuir, fuir sans trahir
"Là-bas" : le mythe de l’ailleurs
"Brouillard" : aux origines de la route
Apprendre à marcher sous la pluie : flâner ou avancer
De l’art du renoncement à celui de l’accueil
Le chemin de moindre résistance
Chemin pour tous, route pour chacun ?
"C’est ensemble" : pas de chemin pour un seul
"Ensemble" : vivre à hauteur d’humain
"Bonne idée" : l’inventaire partagé d’un chemin singulier
L’homme du "entre" : Goldman, flâneur ou aventurier ?
Ni flâneur, ni aventurier : une marche à taille humaine
Le refus des extrêmes : marcher, sans s’ériger
Une philosophie du pas après l’autre
Chemins de vie : l’origine et l’ancrage
Il y a des chemins qu’on ne choisit pas. Ils s’imposent à nous, comme un héritage silencieux. Ils ne mènent nulle part, parfois. Ils serpentent en nous sans bruit, ou bifurquent sans prévenir. Et c’est peut-être ce qui les rend si présents dans l’œuvre de Jean-Jacques Goldman. Le chemin, chez lui, ne se résume jamais à une simple ligne de fuite. Il est ce que l’on reçoit, ce que l’on devine, ce que l’on porte en soi. Il est aussi — et peut-être surtout — ce que l’on tente de comprendre.
Contrairement à la route, qui pousse vers l’extérieur, le chemin semble ici désigner l’intérieur. Celui de la psyché, du passé, de l’identité. Il n’est pas question d’aller loin, mais de savoir d’où l’on vient, et ce que cela veut dire. C’est dans cette perspective que trois chansons majeures se détachent : "Ton autre chemin", "Bonne idée" (06) et "Tu es d’un chemin" (07).
Le chemin des autres : "Ton autre chemin" ou l’énigme de l’âme
Écrite en 1984, "Ton autre chemin" s’impose comme l’une des chansons les plus bouleversantes de Goldman. Elle évoque le basculement d’un ami proche dans la maladie mentale. D’abord par l’absence, puis par le silence, enfin par la perte de lien : « Et puis, tu as commencé à être absent / Souvent, puis plus longtemps ». Le refrain revient comme une supplique : « Montre-moi ton autre chemin ».
Ce que chante Goldman ici, c’est l’impossibilité d’accéder à la réalité intérieure d’un être qui s’éloigne. Non pas physiquement, mais psychiquement. Il n’est pas question de route, de départ vers un ailleurs exotique. Le voyage est intérieur — et il est inaccessible à celui qui reste. Le mot "chemin" devient alors le nom poétique de cette altérité radicale.
Goldman ne juge pas. Il ne parle pas de "folie", ni de "trouble". Il choisit une image douce, presque spirituelle : un autre chemin. Celui que l’on ne peut pas emprunter, mais que l’on peut essayer d’honorer. Il tente même, dans une série de vers d’une grande tendresse, de se glisser dans le monde de l’autre :
Dis-moi tes signes et dis-moi ton langage Les horizons des barreaux de ta cage Vois-tu le blanc, le bleu-ciel et le rose Que vois-tu quand tes paupières se closent ? »
La chanson devient un pont tendu au-dessus de l’incommunicable. Ce chemin, si éloigné soit-il, Goldman essaie de le rejoindre. Non pour sauver, mais pour comprendre. Il signe ici un geste rare dans la chanson française : celui de regarder sans détour un être marginalisé, non pas comme un autre, mais comme un frère.
Le chemin de soi : "Bonne idée" ou l’inventaire de la vie reçue
Treize ans plus tard, Goldman écrit "Bonne idée". Et là encore, il est question de chemin. Mais cette fois, il s’agit du sien. Ou plutôt : de celui que chacun d’entre nous pourrait retracer, avec un peu de mémoire et beaucoup d’humilité. La chanson déroule une sorte d’inventaire à la Prévert, mêlant anecdotes, sensations, souvenirs, saveurs. Elle s’ouvre sur ces mots étonnants :
Un début de janvier, si j’ai bien su compter Reste de fête ou bien vœux très appuyés De Ruth ou de Moïshé, lequel a eu l’idée ? Qu’importe j’ai gagné la course, et parmi des milliers Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers
Le ton est léger, presque badin. Mais l’enjeu est immense : retracer l’origine, raconter la naissance, faire de la vie une succession de petits miracles. "Bonne idée" est une ode à l’existence ordinaire, à ces chemins minuscules qui nous façonnent jour après jour.
Et parmi eux, Goldman cite les routes — au pluriel — comme s’il s’agissait de repères sensibles :
Y’avait du soleil, des parfums, de la pluie Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit Des routes et des motards et des matchs de rugby Des spaghetti, Frédéric Dard et Johnny Winter aussi
La route n’est pas ici le lieu de l’aventure, mais celui de la familiarité. Elle devient une image de l’enfance, du monde qui défile, de ce qu’on apprend à aimer. C’est un chemin affectif plus qu’un itinéraire. Goldman ne le dit pas, mais tout est là : l’émotion est une boussole, et le bonheur une série de traces laissées sur la carte du quotidien.
Dans une interview à Télé 7 Jours en octobre 1997 (08), il confie : « J’aime les routes de traverse qui mènent à une destination inconnue. […] Winter est le guitariste qui m’a le plus influencé. […] Quant à Frédéric Dard, il s’approprie les mots, les triture comme personne. »
Ce sont ces influences qui constituent son chemin. Non pas un grand destin, mais un chapelet de détails, de passions, de rencontres — et toujours cette envie de faire un pas de côté, loin de l’autoroute toute tracée.
Le chemin des origines : "Tu es d’un chemin" ou l’affirmation d’une filiation
Enfin, comment ne pas évoquer "Tu es d’un chemin", écrite pour Lââm en 2004 ? C’est l’une des chansons les plus explicites de Goldman sur la notion de transmission. Elle ne parle pas d’un départ, mais d’une appartenance. D’un héritage.
Tu es d'un chemin Nos anciens, notre passé Notre trésor, notre fierté Qui nous montre notre chemin
Ici, le mot "chemin" devient une balise généalogique. On est d’un chemin, comme on est d’un pays, d’un peuple, d’une blessure. Goldman insiste sur le "d’un" : il ne dit pas ton chemin, mais d’un chemin, comme s’il s’agissait d’un bien commun, d’une histoire partagée — ou oubliée.
La chanson résonne comme un rappel identitaire, mais sans crispation. Il ne s’agit pas de revendiquer, mais de reconnaître. De regarder juste derrière soi, comme il le chante, pour comprendre ce qui a mené jusqu’à aujourd’hui.
Et Goldman, encore une fois, ne le fait pas pour dénoncer, ni pour condamner. Il cherche à relier. À redonner du sens à ce qui a été tu. Dans une époque où l’on valorise l’individu sans attaches, il propose au contraire une lecture relationnelle de l’existence : on est de quelque part, et c’est bien ainsi.
À travers ces trois chansons, une même figure se dessine : celle d’un homme qui croit aux chemins. Pas seulement comme trajets, mais comme récits. Comme identités. Goldman ne s’aventure pas ici sur les grands espaces de l’ouest américain, ni sur les routes du destin. Il regarde plus près. Il écoute. Il parle doucement, mais avec gravité. Et ce qu’il nous dit, c’est peut-être cela : il faut connaître ses chemins pour pouvoir un jour prendre la route.
Routes de fuite, routes de foi : partir, malgré tout
Il y a des routes qu’on prend pour fuir. Et d’autres pour renaître. Chez Jean-Jacques Goldman, il est souvent difficile de faire la distinction. Car fuir n’est pas toujours lâcher. Et partir n’est pas toujours trahir. La route, dans son œuvre, n’est ni une ligne droite ni une autoroute. C’est un espace d’entre-deux, un territoire d’ambiguïté. C’est là que se jouent les choix les plus profonds — ceux qui engagent l’être tout entier.
Ce n’est pas un hasard si certaines de ses chansons les plus populaires tournent autour de ce thème. "On ira", "Je m’en vais demain", "Puisque tu pars", "Là-bas" : autant de titres qui disent la tension entre ce que l’on quitte et ce que l’on espère. Partir, dans ces chansons, n’est jamais seulement changer de décor. C’est aussi, et peut-être surtout, changer de vie.
"On ira" : la route sans destination
Sans doute l’une de ses chansons les plus emblématiques, "On ira" (1997) est une apologie frontale des routes. Goldman y chante l’envie d’ailleurs, mais sans nommer cet ailleurs. Mieux : il le vide de sa substance pour magnifier ce qui y mène.
On partira toi et moi, où ? je sais pas Y’a que les routes qui sont belles Et peu importe où elles nous mènent
Le renversement est total : ce n’est plus la destination qui importe, mais le déplacement lui-même. La route n’est plus un moyen — elle devient une fin. Goldman rompt ici avec l’idée traditionnelle du but. Il inscrit son œuvre dans une logique de mouvement pur, presque philosophique : avancer, même sans savoir pourquoi.
Dans un entretien donné à Nostalgie en 1997 (09), il le dit clairement : « Je pense plus qu’une chanson sur la personne que j’emmène, c’est une apologie des routes. Le fait de dire que le plus important n’est pas la destination. […] Le plus important c’est finalement la route pour aller d’un endroit à l’autre. »
Ce refus de la destination, cette désidéalisation de l’ailleurs, Goldman l’explique encore plus crûment face à Gaël (10), dans un échange rare. Confronté à une phrase du romancier Milan Kundera, qui dit qu'il est complètement stupide et vain de penser que la vie est ailleurs, Jean-Jacques Goldman répond : « Il y a pire : penser que la vie est avec quelqu'un d'autre. C'est aussi une grande illusion. Ailleurs et avec quelqu'un d'autre. Les gens sont partout pareils et les destinations sont les mêmes. Mais c'est une jolie illusion de penser qu'il y a ailleurs. Cela permet d'avancer. »
Devant la réaction perplexe du journaliste de Gaël, il insiste : « Il faut rester sur la route. Cela ne sert à rien d'arriver. La clé est là. Ce n'est pas telle personne ou tel endroit qui est l'aboutissement mais c'est le fait d'y aller ».
Le propos est à la fois désenchanté et lumineux. Goldman n’y croit pas, mais il en a besoin. Il sait que l’illusion du départ, même fausse, permet de rester vivant. De ne pas se figer. C’est le grand Ouest, les chercheurs d’or — non pas ceux qui trouvent, mais ceux qui cherchent.
"Je m’en vais demain" : écrire sa propre route
Écrite pour Dan Ar Braz en 2003, et interprétée en duo avec lui, "Je m’en vais demain" prolonge ce thème, avec une gravité douce. Ici, la route est moins fantasmée que dans "On ira". Elle n’est pas seulement belle : elle est nécessaire. C’est une ligne de survie.
Je m’en vais demain ou peut-être après-demain Pour une route à écrire, une ligne dans ma main
Ce vers condense à lui seul toute une philosophie : l’avenir n’est pas tracé, il est à tracer. Il ne suffit pas de suivre un chemin, il faut le créer. Et ce geste est vital :
Qu’importe le temps, je veux le souffle des vents Laissez mes bagages, je n’emporte rien Qu’un peu de courage et quelques rêves d’enfants
Goldman écrit ici pour un autre — mais la tentation de partager le micro était trop forte. On retrouve donc sa voix, celle d’un homme qui sait que rester, c’est s’éteindre. Que les bagages, les conforts, les certitudes sont des poids. Et que l’essentiel tient en peu de choses : du vent, des rêves, du courage.
Dans le dossier de presse de l’album "A toi et ceux" raconte : « Je lui avais dit "Jean-Jacques, j’aimerais bien que tu m’écrives quelque chose de profond mais d’une manière légère". […] Ce qu’il a magnifiquement fait. »
La route devient alors une surface vierge, à écrire. Une promesse de recommencement. Une échappée belle, non pour fuir les autres, mais pour se retrouver.
"Puisque tu pars" : partir sans fuir, fuir sans trahir
Dans "Puisque tu pars" (1987), Goldman explore un autre angle du départ : celui qui est subi. Le narrateur ne part pas — c’est l’autre. Et pourtant, toute la chanson est une déclaration d’acceptation. Une tentative d’élégance dans la perte.
Le verbe "partir" devient ici une métaphore de la séparation, du renoncement. Mais Goldman refuse la colère, le ressentiment. Il choisit la dignité. Il fait du départ un geste poétique. Et il en sauve quelque chose : un sens, une grandeur.
Puisque c'est ailleurs Qu'ira mieux battre ton coeur Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir Puisque tu pars
La route est ici celle de l’autre — mais elle oblige le narrateur à inventer la sienne. Non pas pour suivre, mais pour continuer. Encore une fois, la route est lien, et non coupure.
"Là-bas" : le mythe de l’ailleurs
Impossible d’aborder la question de l’ailleurs chez Goldman sans citer "Là-bas" (1987). Ce duo avec Sirima oppose deux voix : celui qui veut partir, et celle qui veut rester. Le conflit est clair, mais la tension reste irrésolue.
Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage Libre continent sans grillage Ici nos rêves sont étroits C’est pour ça que j’irai là-bas
La route est ici exaltée, mais elle est aussi porteuse d’illusion. Loin d’être un simple élan, elle est une fuite. Une fuite vers un ailleurs fantasmé, peut-être inaccessible. L’autre voix — celle de Sirima — incarne le doute, la peur, l’ancrage.
N'y va pas Y'a des tempêtes et des naufrages Le feu, les diables et les mirages Je te sais si fragile parfois Reste au creux de moi
Goldman ne tranche pas. Il ne dit pas qui a raison. Il laisse le débat ouvert. Il comprend le désir de partir. Il respecte la décision de rester. Et peut-être est-ce là le plus grand geste : reconnaître que la route n’est pas toujours la réponse. Qu’elle peut être un mirage.
À travers ces quatre chansons, la route apparaît tour à tour comme projection, fuite, renaissance, deuil, promesse. Elle est un lieu de passage, mais aussi de vérité. Elle permet à chacun de se confronter à ses limites. De repousser ses peurs. De croire encore, malgré tout.
Et même si, comme le dit Goldman, "les destinations se ressemblent", il y a dans l’acte même de partir une énergie vitale. Quelque chose qui relève de la foi. Non pas foi religieuse, mais foi en la vie, en la possibilité d’un ailleurs — même symbolique.
Même si tout est joué d’avance, on ira, on ira.
Le clin d’œil à "Là-bas" qu’on retrouve dans "On ira" est voulu. Goldman le confirme avec simplicité : « C'est une référence à cette envie de partir. Et, puisque tout est joué d'avance, à forcer un peu le destin, quoi. » (09)
"Brouillard" : aux origines de la route
Bien avant "On ira", bien avant "Là-bas", Jean-Jacques Goldman avait déjà, en creux, posé les jalons de son rapport à la route comme rupture, comme nécessité vitale. En 1981, dans son tout premier album solo, une chanson discrète, mais fondatrice, en porte les signes avant-coureurs : "Brouillard" (11).
Dès les premières strophes, tout est là : le froid, la fatigue, la routine, la résignation. Le brouillard n’est pas seulement climatique, il est existentiel. Il brouille la tête, use les gestes, empêche de se projeter :
Brouillard et matin / Blanches et froides mes mains Le poids du sac aux épaules [...] L'heure n'est pas aux projets, regrets passés, oubliés rêves et délires
Et pourtant, une voix intérieure, ténue mais insistante, invite à partir. À fuir cette immobilité. À s’arracher. Comme un feu sous la cendre :
Je prendrai la nationale / Guidé par une évidence Par une fièvre brutale / Et je partirai
Ce départ n’est pas un luxe. C’est une urgence. Une renaissance. Le vocabulaire est fort : "évidence", "fièvre", "brutale", "renaître". On sent déjà poindre ce que Goldman écrira bien plus tard dans "Je m’en vais demain" ou "On ira" : partir non pour fuir le monde, mais pour échapper à l’enlisement.
Certains vers résonnent avec une intensité troublante tant ils annoncent des chansons ultérieures :
Oublier les visages Regretter son sourire Les larmes au coin de ses cils
Ces mots pourraient figurer dans "Là-bas", tant ils en anticipent le cœur battant : le tiraillement entre l’appel du départ et le poids de ceux qu’on laisse. Mais ici, la voix est plus seule, plus brute, plus nue. Il n’y a ni promesse, ni compagnon de route, ni grand discours. Seulement un pas, un corps, une décision. Et une route qui claque sous les pieds.
Il est frappant de constater que l’un des tout premiers morceaux de Goldman contienne déjà les germes de cette tension centrale dans son œuvre : partir, oui — mais à quel prix ? Et pour aller où, sinon vers soi ?
"Brouillard", c’est le moment zéro de cette dialectique. Une chanson presque austère, mais précieuse, parce qu’elle dit sans détour ce que toutes les autres chercheront à affiner, à humaniser, à partager : le besoin de rompre pour ne pas sombrer. La route, déjà, comme dernier recours.
Apprendre à marcher sous la pluie : flâner ou avancer
Il est des chansons de Goldman qui ne s’imposent pas d’emblée. Elles n’ont pas le souffle épique de "Là-bas", ni l’intensité émotionnelle de "Je te donne". Mais elles s’infiltrent lentement, comme l’eau dans les failles. "La pluie", chanson discrète figurant sur l’album "Chansons pour les pieds" (2001), fait partie de celles-là. Derrière sa légèreté apparente, elle dissimule un regard profond sur le monde, sur le rapport au réel, sur l’art de marcher… même quand il pleut.
La pluie, chez Goldman, n’est pas seulement une donnée météorologique. Elle devient métaphore de la difficulté, de l’épreuve, du malaise existentiel. Et face à cette pluie, chacun choisit son camp : se réfugier ou affronter, se cacher ou avancer.
On voudrait savoir éviter la pluie Entre les gouttes se glisser Deux, trois nuages et l’on court à l’abri On n’aime pas trop se mouiller
La première strophe dresse un constat lucide : la peur de l’inconfort gouverne bien des vies. On court à l’abri dès que l’averse menace, on se couvre, on se recroqueville. L’image n’est pas anodine. Elle dit quelque chose de notre époque : la tentation du repli, la peur du désordre, le fantasme d’un monde sans aspérités.
Mais Goldman ne s’arrête pas là. Il observe ce comportement comme un entomologiste observe une colonie d’insectes. Il le met à distance. Il l’interroge. Et bientôt, il le dépasse.
Pas de jolie vie, de joli chemin Si l’on craint la pluie
Voilà le basculement. Le lien est explicite entre le chemin — déjà abordé dans les chapitres précédents — et l’acceptation de l’épreuve. Il n’y a pas de vraie vie, pas de trajectoire pleine, sans passage par la pluie. À refuser l’averse, on s’interdit la beauté du chemin. La métaphore devient morale. Elle invite à sortir des abris, à faire face, à ne pas redouter l’imperfection du monde.
Goldman, ici, se fait presque stoïcien. Il ne nie pas la difficulté. Il n’édulcore rien. Mais il invite à traverser. Mieux : à marcher dans la pluie, le visage offert.
Mais dans les vies sèches L’eau se venge aussi : Y’a des ouragans, des moussons, des déserts Autant apprendre à marcher sous la pluie Le visage offert
C’est sans doute l’un des plus beaux vers de son répertoire. Il y a là une forme de sagesse active, de poésie discrète, qui rappelle les grands textes de Camus. Refuser la pluie, c’est la condamner à revenir plus fort, plus brutalement. La sécheresse est trompeuse ; elle prépare l’orage. Alors, autant faire le choix d’avancer sous la pluie, humblement, résolument.
Cette posture n’est pas celle du héros. Ce n’est pas l’épopée. C’est l’élégance du flâneur, qui marche à son rythme, qui observe, qui s’imprègne du monde sans chercher à le dominer. Le flâneur n’est pas un lâche. Il n’est pas non plus un combattant. Il est un témoin lucide, un passant engagé. Chez Goldman, il prend des traits discrets : pas de revendication, pas de grands discours — mais une ligne de conduite ferme. Ne pas renoncer à avancer. Même trempé. Même transi. Implacable, il assène : « C’est la route elle-même qui est intéressante ». (12).
C’est une philosophie du pas après l’autre, de la résistance tranquille.
De l’art du renoncement à celui de l’accueil
Dans les paroles, la météo devient une grille de lecture du réel. Le monde est capricieux, instable, injuste. On peut le maudire. On peut aussi en faire un allié. Goldman ne choisit pas le fatalisme, ni l’optimisme béat. Il invite à l’ajustement intérieur. À l’acceptation active.
On prie le ciel, et les grenouilles et l’hirondelle Que le temps tourne Comme tourne la chance Dieu que tout baigne quand il y a du soleil Mais voilà, le mauvais temps, ça recommence
Les prières ne changent rien. Les superstitions non plus. Il faut faire avec. C’est peut-être cela, la maturité chez Goldman : accepter de ne pas être maître du ciel. Et marcher quand même.
L’éclat de cette chanson vient aussi de son refus de toute posture victimaire. Le narrateur ne se plaint pas. Il constate. Il s’adapte. Il garde la tête haute. Il avance. Cela peut sembler peu — c’est immense.
Le chemin de moindre résistance
Dans une société saturée d’objectifs, de productivité, de vitesse, "La pluie" propose une autre temporalité. Une autre forme de courage. Celui de rester debout sous l’averse. De ne pas se liquéfier. D’attendre que ça passe — mais en mouvement.
Ce n’est pas une chanson d’évasion. C’est une chanson d’endurance. De présence au monde. D’attention. Le flâneur que dessine Goldman ici n’est pas l’artiste maudit ou le bohème exalté. C’est un citoyen discret. Un humain ordinaire, qui sait que la beauté n’est pas dans le soleil, mais dans la manière d’accueillir la pluie.
Et peut-être que ce que Goldman nous invite à comprendre rejoint cette pensée souvent attribuée à Sénèque : « La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie ». Il y a là un geste presque politique. Dans une époque d’évitement, de conforts illusoires, de routes "sans aspérités", Goldman rappelle qu’on ne vit pas sans friction. Et que ces frictions — ces averses — sont aussi ce qui nous construit.
Dans "La pluie", la route n’est pas belle comme dans "On ira". Elle n’est pas choisie comme dans "Je m’en vais demain". Elle n’est pas déchirante comme dans "Puisque tu pars". Elle est grise, trempée, ingrate. Mais elle est là. Et il faut la prendre.
Car la vie n’est pas faite que d’éclaircies. Elle est faite de passages. Et ce que propose Goldman, dans cette chanson presque invisible, presque effacée, c’est une manière de les traverser. Sans se cacher. Sans fuir. Sans illusion. Mais avec grâce.
Chemin pour tous, route pour chacun ?
Chez Jean-Jacques Goldman, il y a souvent quelqu’un d’autre dans le paysage. Quelqu’un à qui l’on parle, quelqu’un qu’on accompagne, quelqu’un qu’on attend. Même dans les chansons de départ ou d’errance, il n’est jamais tout à fait seul. Et lorsqu’il évoque la route, il ne la pense pas uniquement comme un cheminement individuel, mais aussi — et parfois surtout — comme un parcours commun.
Ce n’est donc pas un hasard si certaines de ses chansons prennent frontalement la parole au nom du collectif. Elles déplacent la focale : du "je" au "nous", du rêve solitaire à l’idéal partagé. Elles montrent que le chemin peut devenir chantier commun, et la route, un destin à écrire ensemble. Cette tension entre le chemin pour soi et le chemin pour tous traverse ainsi tout son répertoire, et donne à son œuvre une portée à la fois humaniste et fraternelle.
"C’est ensemble" : pas de chemin pour un seul
Écrite en 2000 pour les "Champions de la Paix", la chanson "C’est ensemble" (13) est sans ambiguïté : la route n’a de sens que si elle est parcourue à plusieurs. Le message est clair, presque manifeste :
C’est ensemble, c’est ensemble qu’on vivra Y’a pas de chemin pour un seul, c’est trop loin, c’est trop froid
Cette formule — "pas de chemin pour un seul" — est d’une puissance rare. Elle inverse la perspective classique du héros solitaire. Elle affirme que l’individu, livré à lui-même, se perd ou se glace. Et que la chaleur du collectif, la solidarité, est une condition de la vie humaine. « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » comme le rappelle le proverbe africain.
Goldman ne parle pas ici d’un rêve communautaire abstrait. Il part du réel, du présent, des injustices du monde :
Les maladies, les drogues et toutes les misères Tu crois qu’elles vont s’arrêter à la frontière ?
Il dénonce l’illusion de la séparation. Il rappelle que le monde est un, que les frontières sont poreuses, que les problèmes des autres finiront par devenir les nôtres. Le trou d’ozone, les enfants sans école, les femmes sans voix : tout cela nous concerne. Pas de chemin individuel possible dans un monde fracassé.
Et pourtant, l’élan reste joyeux. La chanson ne culpabilise pas — elle mobilise. Elle prend appui sur l’expérience : celle du chant partagé, de la disharmonie initiale devenue harmonie par l’écoute. Une leçon de vie glissée dans un atelier vocal :
Souviens-toi quand on a commencé à chanter C’était trop nul chacun de son côté À force de répéter et de s’écouter C’est l’harmonie qui a gagné
Ce n’est pas qu’une métaphore : c’est une méthode. Marcher ensemble demande du temps, de l’écoute, des ajustements. Mais cela vaut l’effort. Cela rend possible un chemin que nul ne pourrait tracer seul.
"Ensemble" : vivre à hauteur d’humain
Dans "Ensemble" (14), parue un an plus tard, Goldman creuse cette même veine. La chanson ne dit pas "on va changer le monde". Elle ne promet pas le grand soir. Elle dit simplement : avançons côte à côte. Faisons ce que nous pouvons. Ensemble.
Ce titre, interprété en canon avec Gildas Arzel, Gérald de Palmas, Michael Jones, et Maxime Le Forestier, se situe à l’intersection du personnel et du collectif. Il rappelle que le vivre-ensemble ne se décrète pas — il se pratique. Et surtout, il se ressent.
J'ai besoin de nos chemins qui se croisent Quand le temps nous rassemble Ensemble, tout est plus joli
Là encore, la route prend une dimension humaine. Elle n’est plus seulement la métaphore d’une quête individuelle, mais celle d’un trajet émotionnel commun. On y avance plus lentement, sans doute — mais on y avance mieux.
Goldman ne se fait pas donneur de leçons. Il ne construit pas une utopie. Il pose juste une évidence simple et belle : dans les grands comme dans les petits moments, l’autre est un appui. Une présence. Un compagnon de route.
"Bonne idée" : l’inventaire partagé d’un chemin singulier
"Bonne idée", déjà abordée dans le premier chapitre sous l’angle de l’origine, contient aussi une dimension collective plus discrète mais tout aussi importante. Sous la forme d’un inventaire personnel, elle dessine en creux une communauté invisible : celle des gens ordinaires, des petits bonheurs, des références partagées.
Des routes et des motards, et des matchs de rugby Des spaghetti, Frédéric Dard et Johnny Winter aussi […] Et puis j’ai vu de la lumière et je vous ai trouvés Bonne idée
Le dernier vers est décisif : je vous ai trouvés. Le "je" rejoint le "vous". La chanson, d’abord introspective, s’ouvre soudain sur une communion implicite. Le narrateur ne célèbre pas sa vie en solitaire : il la relie à d’autres. Ceux qu’il croise, ceux qu’il aime, ceux qui l’accueillent, ceux qui le suivent. Il y a une chaleur dans cette inclusion finale, une sorte de reconnaissance : ce sont les autres qui donnent sens à la route.
Dans une interview donnée à Télé 7 Jours (15), Goldman le dit autrement : « J’aime les routes de traverse qui mènent à une destination inconnue. »
Ce chemin-là n’est pas grandiose. Il ne promet pas la gloire. Mais il est peuplé. Humain. Vivant.
Il serait tentant d’opposer le chemin personnel aux chemins collectifs. De croire qu’il faut choisir entre marcher seul et marcher avec les autres. Mais chez Goldman, cette tension n’est pas un dilemme — c’est un équilibre. L’un nourrit l’autre. Le chemin intime n’a de sens que s’il débouche sur une route partagée. Et la route commune n’a de force que si chacun y apporte son histoire, sa voix, ses couleurs.
Y’a pas de chemin pour un seul, c’est trop loin, c’est trop froid.
Cette phrase revient comme un leitmotiv. Elle pourrait être un programme politique, un principe éducatif, un idéal de société. Mais elle est d’abord, chez Goldman, un geste d’écriture. Une manière de dire que dans l’œuvre comme dans la vie, rien ne se fait sans l’autre.
L’homme du "entre" : Goldman, flâneur ou aventurier ?
Depuis le début de cet essai, deux mots guident notre exploration : chemin et route. Deux termes proches, mais que Jean-Jacques Goldman emploie toujours avec nuance. Le chemin, dans ses chansons, est souvent intime, enraciné, chargé de mémoire ou de silence. La route, elle, ouvre vers l’extérieur, l’inconnu, la promesse ou l’illusion d’un ailleurs. L’une invite à se souvenir. L’autre incite à partir.
Mais faut-il vraiment les opposer ? Ou faut-il, à l’image de Goldman lui-même, apprendre à marcher entre les deux ?
Ni flâneur, ni aventurier : une marche à taille humaine
Si l’on cherche une figure archétypale dans l’œuvre de Goldman, ce n’est ni celle du héros ni celle du fugitif. Ce n’est pas non plus celle du philosophe solitaire ou du globe-trotteur exalté. C’est celle du marcheur. Un être simple, conscient de ses limites, mais qui choisit quand même d’avancer.
Goldman n’idéalise ni la route ni le chemin. Il les explore comme deux modalités de vie. Et ce qui l’intéresse, au fond, ce n’est ni le point de départ ni le point d’arrivée. C’est ce qu’on fait en marchant. Ce qu’on découvre, ce qu’on perd, ce qu’on retrouve.
Dans l’entretien qu’il accorde à Wit FM en 1997 (16), il le dit sans détour : « Les destinations sont pas aussi importantes qu'on le croit. Arriver à quelque chose, c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est d'y aller, c'est la route pour y aller. »
Le plus important, donc, c’est le mouvement. Mais un mouvement non spectaculaire, non héroïque. Une progression modeste. Le pas après l’autre. Le mot route, chez Goldman, n’est pas synonyme d’épopée : il dit l’effort, l’insistance, la continuité.
Dans "La pluie", il pousse cette logique jusqu’à sa forme la plus dépouillée : « Autant apprendre à marcher sous la pluie, le visage offert. »
Il n’y a pas de soleil attendu. Pas de récompense. Seulement une manière d’être là. Présent au monde. Présent à soi.
Le refus des extrêmes : marcher, sans s’ériger
Goldman n’a jamais eu la tentation du gourou, du prophète ou du martyr. Il ne se présente pas comme un guide, mais comme un compagnon. Il chante au niveau du sol. Et dans ses chansons, les départs ne sont jamais des ruptures brutales : ce sont des bifurcations.
Dans "On ira", il ne promet pas de trouver un eldorado. Il dit simplement que les routes sont belles, même si "tout est joué d’avance". Ce n’est pas un cri de révolte. C’est un souffle de courage. L’envie de ne pas renoncer. D’oser l’élan. D’oser l’erreur aussi.
Même si tout est joué d’avance, on ira, on ira.
La même humilité se retrouve dans "Je m’en vais demain" :
Je m’en vais demain ou peut-être après-demain Pour une route à écrire, une ligne dans ma main. »
Le doute est toujours là. La prudence aussi. Mais l’élan l’emporte. Ce n’est pas une fuite. Ce n’est pas une conquête. C’est un appel doux. Un besoin d’air. D’autrement.
Même dans "Là-bas", l’une de ses chansons les plus ambivalentes, Goldman refuse de trancher. Il donne la parole aux deux : à celle qui reste, et à celui qui part. Il ne choisit pas son camp. Il les écoute. Il les comprend.
Cette posture — écouter sans juger, avancer sans écraser — définit peut-être son éthique profonde. Il n’est pas là pour baliser le monde. Il est là pour marcher avec. Pour témoigner, doucement. Pour dire que, même dans la grisaille, même dans l’incertitude, il est possible de continuer.
Une philosophie du pas après l’autre
Goldman est un marcheur. Pas un coureur de fond, pas un sprinteur. Un marcheur au sens presque spirituel du terme. Un homme en chemin, qui sait que la ligne droite n’est ni possible, ni souhaitable. Que l’on avance parfois à reculons. Que les détours sont souvent les seules voies.
Cette philosophie affleure dans toute son œuvre. Dans les textes, mais aussi dans sa manière de mener sa carrière. Pas d’effet de manche. Pas de virage marketing. Une trajectoire cohérente, lente, exigeante. Des arrêts assumés. Des absences prolongées. Et toujours cette fidélité à une idée simple : c’est la manière dont on marche qui compte. Pas le nombre de kilomètres.
« Dans la vie, au départ, on veut obtenir des choses […] Ensuite, on se rend compte que le plus intéressant, ce n’est pas ce que l’on obtient, c’est la route pour y arriver. […] L’intérêt d’une vie, ce sont ces routes… pas les réussites. » (17)
Il n’y a pas plus clair. Le but ne fait pas le sens. Le sens vient du chemin. Et ce chemin-là ne se parcourt pas seul. Il se partage. Il se chante. Il se transmet.
Goldman est-il flâneur ? Un peu. Il aime les routes de traverse. Les inattendus. Les mots perdus. Il regarde le monde avec lenteur, avec acuité. Mais il ne s’arrête pas là.
Est-il aventurier ? Par moments. Quand il part, quand il quitte, quand il ose le saut dans l’inconnu. Mais il n’en fait jamais un mythe.
Il est, d’abord et avant tout, un homme du entre. Entre deux lieux. Entre deux âges. Entre deux mots. Entre deux certitudes. Et c’est dans cet entre-deux que se déploie toute la beauté de son œuvre.
Il ne trace pas une route. Il n’éclaire pas un chemin. Il marche. Et ce faisant, il nous apprend que marcher, même sans savoir où l’on va, est déjà un acte de foi. Une preuve d’espoir. Une forme d’amour.
Sources
- (01) Jean-Jacques Goldman : On ira (1997)
- (02) Jean-Jacques Goldman : Ton autre chemin (1984)
- (03) Jean-Jacques Goldman : La pluie (2001)
- (04) Jean-Jacques Goldman : Puisque tu pars (1987)
- (05) Dan Ar Braz et Jean-Jacques Goldman : Je m'en vais demain (2003)
- (06) Jean-Jacques Goldman : Bonne idée (1997)
- (07) Lââm : Tu es d'un chemin (2004)
- (08) Jean-Jacques Goldman : "le bonheur est obscène" (Télé 7 Jours, 7 octobre 1997, propos recueillis par Fabrice Guillermet)
- (09) Week-end Jean-Jacques Goldman, Nostalgie, 26-27 septembre 1997, propos recueillis par Christophe Nicolas
- (10) Jean-Jacques Goldman, flâneur sur la Terre (Gaël, 24 septembre 1997)
- (11) Jean-Jacques Goldman : Brouillard (1981)
- (12) Livre de partitions "En passant" Hit Diffusion, juin 1998, propos recueillis par Paul Ferrette
- (13) Champions de la Paix : C'est ensemble (2000)
- (14) Jean-Jacques Goldman : Ensemble (2001)
- (15) Jean-Jacques Goldman : "le bonheur est obscène" (Télé 7 Jours, 7 octobre 1997, propos recueillis par Fabrice Guillermet)
- (16) Wit FM, 23 octobre 1997, propos recueillis par Hervé Beaudis
- (17) Livre de partitions "En passant" Hit Diffusion, juin 1998, propos recueillis par Paul Ferrette